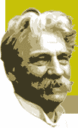Protection des Animaux
01. Analyse
Fondements philosophiques
La considération pour la vie animale, le souci de ne pas faire souffrir les animaux, de les épargner et de les protéger apparaissent (dans le texte et la vie de Schweitzer) comme une application immédiate du principe éthique du respect pour la vie. En effet, tout doit se conclure pour chacun de cette réalité première: que chacun est vie parmi la vie, jeté à même la vie au milieu d’une infinité de vies. L’être humain qui parle et qui s’explique de cette façon est saisi là dans sa nudité originelle d’être vivant, d’être-de-la-vie, avant d’être considéré comme « roseau pensant » ou sujet parlant ou encore être-de-la-culture, homo sapiens et homo faber apte à fabriquer des outils et à transmettre ses techniques. Toutes ces déterminations ont leur valeur et sont essentielles pour l’anthropologie, la connaissance que l’homme peut avoir de lui-même, mais elles sont secondes par rapport à la réalité physique – et métaphysique – primordiale de son existence d’être vivant qui veut vivre…
De la conscience de cette réalité, qu’est l’appartenance et la participation des humains à la vie, découle – logiquement – la conscience d’une égalité entre toutes les « créatures » en tant que créatures, en tant que provenant toutes d’une même mystérieuse, insondable origine ou, dit autrement: en tant que rien provenant de Rien. De cette égalité, d’origine et de sort final, de sens ou d’insignifiance, c’est comme on voudra s’exprimer, résulte, peut résulter, et soit dit par métaphore, la conscience d’une fraternité: « animaux et plantes, nos frères, nos soeurs ». Schweitzer avait été très tôt émerveillé par la pensée de François d’Assise et il expliquera plusieurs fois que ce que celui-ci avait annoncé sur un mode poétique et comme une perspective du royaume des cieux, lui l’énonçait sur un mode philosophique, dans l’éthique et pour une pratique, sinon même une politique.
Sensibilité
Comme toujours chez Schweitzer (et chez d’autres penseurs) la sensibilité – et on pourrait dire aussi la vie – a précédé l’intelligence théorique. A Gunsbach, l’enfant, de lui-même, ajoutait à la prière du soir quelques mots pour demander que Dieu protège également les animaux, qu’ils « protège et bénisse tout ce qui respire ». C’est sans doute son enracinement rural, son enfance passée à la campagne, dans le petit village d’une vallée vosgienne, qui a donné à Schweitzer très tôt et pour toujours une connaissance effective, quotidienne, « naturelle », de la vie animale, une expérience et une sensibilité ainsi irremplaçable, qui s’est répercutée profondément dans son oeuvre, au coeur de sa philosophie même, et qui le distingue immédiatement de tous ceux qui, comme son petit-cousin Jean-Paul Sartre, par exemple, ont « grandi dans une bibliothèque » et se sont élevés dans les seuls « mots », sans jamais voir de près et toucher, caresser ou aussi frapper, une bête. Aussi peut-on affirmer doctement que Schweitzer ne serait pas devenu le penseur de l’éthique du respect pour la vie, s’il avait eu une enfance…différente, citadine et bourgeoise.
Les animaux à la campagne, « au milieu » des hommes – vie qui veut vivre « au milieu » de la vie qui veut vivre -, et aussi, à l’époque, les animaux en ville, les chevaux, bêtes de trait. Schweitzer, que le spectacle d’un vieux cheval boiteux mené à l’abattoir rendait déjà malade à Gunsbach, était bouleversé par leur condition dans les rues de Strasbourg, de Paris ou de Barcelone.
Du haut de sa chaire en l’église Saint-Nicolas, le jeune pasteur dénonce, sur la foi d’un article de journal, les procédés barbares employés dans les abattoirs de la ville de Strasbourg et il fait part à ses paroissiens d’une conversation qu’il a eue avec un charretier, livreur de charbon, un brave homme, contraint de malmener son cheval. Le pasteur montre le mal qui règne partout dans le monde et tout près de chez nous, dans nos rues et derrière nos murs, et pourtant, explique-t-il, les hommes ne sont pas ou rarement méchants, mais faibles.
A Barcelone, la même année, il s’affligea de voir ses amis courir à la corrida et menaça de descendre d’une calèche si le cocher n’arrêtait pas de maltraiter son attelage.
Tous ceux qui aujourd’hui dénoncent certaines chasses sportives ou traditionnelles, les vivisections et « le grand massacre » que constitue l’élevage intensif en batterie (« illustration du naufrage éthique et spirituel des sociétés industrialisées ») pourraient se reconnaître dans ce que Schweitzer a écrit il y a longtemps déjà, au début du siècle. Des militants illustres de ce combat marginal, comme Alfred Kastler ou Théodore Monod, le connaissaient personnellement et furent de ses amis.
02. Textes à l'appui
A l’orée de la forêt vierge
Chapitre IV : De juillet 1913 à janvier 1914
Les mouches tsé-tsé apparurent dès le lever du soleil. Elles ne volent que de jour. Les pires moustiques ne sont, en comparaison, que des êtres inoffensifs. La tsé-tsé a environ une fois et demie la taille de notre mouche commune, à laquelle elle ressemble, si ce n’est que ses ailes, au lieu d’être parallèles, recouvrent son corps comme les deux lames d’une paire de ciseaux.
Pour se gorger de sang, la mouche tsé-tsé pique à travers les tissus les plus épais. Elle est aussi prudente que rusée, et esquive la main qui veut la frapper. Dès qu’elle sent que le corps sur lequel elle s’est posée fait le moindre mouvement, elle s’envole et se cache contre les parois du bateau. Son vol est silencieux. On ne peut s’en défendre dans une certaine mesure qu’au moyen de petits plumeaux. Elle est bien trop avisée pour se poser sur un fond clair où on la découvrirait aussitôt. La meilleure manière de s’en préserver consiste donc à porter des vêtements blancs.
J’ai vu cette règle se vérifier durant notre voyage. Deux d’entre nous étaient habillés de blanc, le troisième avait un vêtement kaki. Ceux-là n’avaient presque pas de tsé-tsé sur eux, mais celui-ci fut constamment agressé; les Noirs eurent à en souffrir le plus.
La mouche tsé-tsé appartient au genre des glossines, qui compte de nombreuses espèces, sous-espèces et variétés en Afrique. La glossina palpalis, qui propage la maladie du sommeil, rentre dans ce groupe.
La civilisation et l’éthique
Chapitre XXI
Que nous enseigne l’éthique du respect pour la vie sur les rapports entre les hommes et les autres créatures de la terre? Chaque fois que je suis sur le point d’abîmer une vie quelconque, il faut que je me pose clairement la question de savoir si c’est nécessaire. Jamais je ne devrai m’autoriser à aller au-delà de l’indispensable, même dans des cas apparemment insignifiants. L’agriculteur qui a fauché des milliers de fleurs dans ses prés pour nourrir ses vaches devra en rentrant chez lui éviter d’arracher, machinalement, une fleur qui pousse au bord de la route, car il attenterait ainsi à la vie, sans se trouver sous l’empire de la nécessité.
Les chercheurs qui expérimentent de nouveaux médicaments sur les animaux ou qui procèdent sur eux à des opérations chirurgicales ou encore leur inoculent des maladies, afin de parvenir à des observations qui pourront servir ensuite à sauver des hommes, ne devraient cependant pas se donner bonne conscience sous le prétexte que leurs nobles fins justifieraient de cruels moyens. Pour chaque cas, il faut qu’ils se demandent, en pesant bien leurs raisons, si vraiment il est nécessaire de sacrifier des vies animales à la cause de l’humanité. Et si oui, qu’ils s’inquiètent et se soucient d’éviter ou d’adoucir au maximum les douleurs. Que de crimes commet-on dans les instituts scientifiques en négligeant de recourir aux techniques de l’anesthésie, car on veut gagner du temps et se simplifier le travail! Et que de tortures sont infligées aux bêtes rien que pour démontrer aux étudiants des résultats déjà acquis et reconnus! Justement parce que les animaux, en tant que cobayes, permettent par leurs sacrifices de remporter tant de précieuses victoires scientifiques, un rapport nouveau de solidarité et de reconnaissance apparaît entre leur monde et le monde de l’homme.
L’obligation d’apporter à tous les êtres vivants tout le bien dont par notre puissance nous sommes capables s’impose dès lors à chacun d’entre nous. En secourant par exemple un insecte qui se trouve menacé, je ne fais rien d’autre que d’essayer de restituer aux animaux dans leur ensemble un peu de la dette coupable, toujours renouvelée, que les hommes ont contractée envers eux. Lorsqu’un animal d’une façon ou d’une autre est exploité pour satisfaire les besoins des hommes, il faut que chacun d’entre nous soit préoccupé des souffrances qui en résultent pour lui. Nul d’entre nous ne doit permettre que ces souffrances soient infligées, si rien ne les justifie. Il a le devoir d’intervenir dans toute la mesure où il le peut. Que personne dans ces conditions ne se dise que ce ne sont pas ses problèmes et qu’il n’a pas à intervenir pour des affaires ne le concernant pas. Que personne ne ferme les yeux et ne fasse comme si le mal n’existait pas, du moment qu’il ne l’a pas vu. Que personne ne se secoue du poids de sa responsabilité. Si les animaux sont victimes de tant de mauvais traitements, si les hurlements du bétail assoiffé pendant son transport en chemin de fer ne sont pas entendus, si tant d’horreurs se perpètrent dans nos abattoirs, si dans nos cuisines des mains inexpertes malmènent les bêtes en voulant les tuer, si des animaux endurent d’invraisemblables tortures par la faute d’hommes impitoyables ou si d’autres encore sont livrés aux jeux cruels des enfants, nous en portons tous une part de responsabilité.
Nous avons peur de nous faire remarquer, lorsque nous laissons voir combien nous sommes affectés par les souffrances que l’homme inflige aux êtres vivants. Nous croyons alors facilement que les autres sont devenus plus « raisonnables » que nous et considèrent comme normal et allant de soi ce qui nous bouleverse. Mais tout à coup leur échappe une parole qui nous montre qu’eux non plus ne sont pas résignés. Ils nous étaient étrangers jusqu’ici et voilà qu’ils nous deviennent tout proches. Le masque d’indifférence qui nous trompait mutuellement tombe. Nous savons désormais que les uns comme les autres, nous sommes hantés par ce qui se passe d’horrible autour de nous. Ah! quel bonheur de nous reconnaître ainsi!
La philosophie et la question du droit des animaux
« La philosophie et la question du droit des animaux », in Cahiers A.S. n°30 et dans l’anthologie « Humanisme et Mystique » (Albin Michel 1995), pp. 116-120
Version originale en anglais, dans International Journal of Animal Protection, 1936
Celui qui examine sérieusement le problème de la compassion pour les animaux sait qu’il est facile de prêcher les bons sentiments en termes généraux, mais infiniment plus difficile d’établir les règles de son application dans les cas concrets. Il ne s’agit pas uniquement de savoir dans quelles conditions l’existence ou le bien-être d’une créature peuvent être sacrifiés à l’existence et aux besoins des hommes, mais aussi de voir comment trancher la question du sacrifice d’une créature à une autre créature. Comment justifier, par exemple, que pour nourrir des oiseaux qu’on a recueillis on attrape des insectes? Quel principe invoquer pour décider le sacrifice d’une multitude d’êtres vivants au bénéfice d’une autre ainsi privilégiée?
L’éthique qui veut nous enseigner le respect et l’amour de toute vie doit en même temps nous ouvrir les yeux sans ménagements sur la nécessité, à laquelle on se trouve soumis de mille façons, de tuer et de nuire, et elle ne doit pas nous dissimuler les conflits qui en résultent sans cesse, pour peu que nous soyons des hommes lucides, résolus à penser ce que nous faisons.
Comme elle perçoit instinctivement les incroyables difficultés où s’embarrasse l’éthique, lorsqu’on étend la loi de l’amour à tous les êtres vivants, la philosophie européenne a toujours cherché, jusqu’à notre époque, à s’en tenir au principe de base, selon lequel l’éthique ne concerne que le comportement de l’homme envers ses semblables et la société, et à ne voir dans l’obligation d’étendre sa sollicitude à tout ce qui vit qu’un élément surajouté à l’édifice de la morale véritable. Certes, la philosophie ne peut ignorer qu’elle entre ainsi en contradiction avec notre sensibilité naturelle. Mais elle préfère cela, plutôt que de se risquer à s’engager dans une éthique de devoirs et de responsabilités sans frontières.
Toutefois elle s’accroche ainsi à une position perdue d’avance. La conscience ne peut se soustraire à une éthique de l’amour et du respect pour toute vie. Il faudra que la philosophie abandonne l’ancienne éthique aux limites étroitement humaines et qu’elle reconnaisse la valeur d’une éthique globale, élargie au-delà de l’humain. En revanche, les partisans de l’amour pour toute créature doivent bien mesurer les difficultés que soulève leur éthique et se résoudre à ne pas jeter un voile sur les inévitables conflits qui éprouvent chacun de nous.
Chercher dans tous les cas concrets une application de l’éthique du respect pour toute vie, telle est la lourde tâche qui s’impose à notre époque.
Sermon du 3e dimanche de l’Avent 1908 (extrait)
Pour nous autres citadins du XXe siècle, le danger est grand de ne rien comprendre au problème des relations entre l’homme et les créatures animales. Un petit nombre seulement d’entre nous possède tout au plus un chien; quant à la vache dont nous buvons quotidiennement le lait, nous ne l’avons jamais aperçue! Notre existence de citadins a érigé entre nous et les animaux comme une muraille de Chine. Les enfants qui grandissent dans nos appartements ne peuvent apprendre, comme ceux élevés à la campagne, ce qui fait la personnalité et l’affectivité profonde de chaque animal. Il leur manquera toujours ce don de compréhension et cette patience indulgente que l’on n’acquiert qu’à la ferme, dans un milieu rural. Nous restons complètement étrangers au sort des animaux et la plupart d’entre nous perdent tout sentiment de responsabilité devant les souffrances que les hommes civilisés leur infligent. Certains calment leur conscience en se disant qu’il existe bien des Sociétés protectrices des animaux et une police qui veille au respect de la loi.
Mais celui qui regarde autour de lui sera tiré de sa quiétude lorsqu’il se rendra compte de tout ce qui se passe et que personne ne se mobilise sérieusement pour dénoncer des scandales quotidiens.
Tous, par exemple, nous étions sûrs et certains que dans nos abattoirs tout se passe selon les règles, tant le slogan « Strasbourg, ville modèle à tous égards » s’était profondément infiltré dans nos esprits. Nous étions donc convaincus qu’à l’abattoir les animaux étaient sacrifiés avec un maximum de précautions qui leur ôtent toute appréhension et évitent les souffrances inutiles – jusqu’à ce que, l’été dernier, quelqu’un soit allé voir de plus près et ait publié le résultat de son enquête. Et voilà que nous apprenons que nos abattoirs sont un véritable enfer pour les bestiaux et que les procédés employés sont indignes d’une institution moderne.
Souvenirs de mon enfance
Chapitre III
Aussi haut que remontent mes souvenirs, j’ai souffert des nombreuses misères qui accablent le monde. Je n’ai jamais connu la véritable joie de vivre, si naturelle à la jeunesse, et je crois que c’est le cas de beaucoup d’enfants, en apparence parfaitement heureux et insouciants.
Je souffrais surtout à la vue des maux et des durs labeurs auxquels sont condamnés les pauvres animaux. Le spectacle d’un vieux cheval boiteux qu’on menait à l’abattoir de Colmar en le tiraillant à la longe par-devant et en le frappant à coups de triques par-derrière, me poursuivit pendant des semaines comme un cauchemar.
Surtout, je n’arrivais pas à comprendre, et cela déjà avant mon entrée à l’école, pourquoi, dans la prière du soir, on ne me faisait intercéder que pour les êtres humains. Aussi, quand ma mère s’était retirée après un baiser et un affectueux « Bonne nuit! », je faisais tout bas une prière supplémentaire. « Bon Dieu, disais-je, protège et bénis tout ce qui respire; préserve du mal tous les êtres vivants et fais-les dormir en paix! »
03. Lettres
Lettres relatant de la protection des animaux
Les termites nous rappellent sans arrêt que notre hôpital est situé dans la forêt vierge. Tantôt on en découvre sur les rayons de la pharmacie, tantôt dans le matériel de pansement,tantôt dans les poutres des bâtiments, tantôt dans les planches entassées, tantôt dans les papiers du bureau. Quelle source d’ennuis constants! Surtout qu’on ne les découvre toujours que lorsque les dégâts occasionnés sont déjà importants. Il s’agit alors de tout enlever afin de connaître l’endroit par lequel ils se sont introduits. Ces insectes nocifs nous contraignent à un travail considérable. A cause d’eux je suis obligé de transvaser dans des boîtes de fer blanc hermétiques tous les médicaments qui me parviennent dans des cartons. Les moyens actuels pour combattre les termites ne donnent guère de résultats convaincants. Récemment, nous avons eu recours au néocide (D.D.T.). Découvert à Strasbourg en 1872, cet insecticide tomba dans l’oubli; on s’en sert à nouveau depuis 1941.
(Lettre de Lambaréné, cahier n°13, mars 1946)
Puis, promenade en voiture. Le cocher frappait de toutes ses forces sur le cheval. Etonnement des autres – le directeur et deux critiques musicaux -, quand je les priai de lui donner l’ordre de cesser de maltraiter ainsi la pauvre bête, s’ils ne voulaient pas que je descende.
Dans les rues, on appelait à se rendre à la corrida… la grande corrida du roi et de la reine, et moi je devais le lendemain jouer de la musique spirituelle pour ce peuple de brutes! Toute cette misère dans le monde parce que les hommes manquent de « compassion »… Pour peu qu’on pense à ces choses, qu’on plonge son regard dans ce qui est », même un ciel bleu au-dessus des palmes devient une désolation.
(Lettre du 25.10.1908, envoyée de Barcelone à Hélène Bresslau)
L’amitié pour les animaux a une signification profonde et c’est quelque chose de magnifique. Dans le calme de Lambaréné, cette sorte d’amitié se développe aisément. Ainsi en ce moment, trois hippopotames passent parfois la nuit près du rivage de l’hôpital, parce qu’ils savent que de nous ils n’ont rien à craindre.
(Lettre du 7.2.1965, à Hans Margolius, Miami)
04. Dans les Cahiers A. S.
Extrait des Cahiers
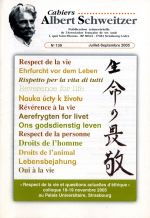
Dans le n° 139, juillet-septembre 2005, qui présentait le colloque « Respect de la vie et questions actuelles d’éthique », une partie du dossier était consacrée à la question : « Respecter et protéger les animaux ».
Texte de Jean-Paul Sorg :
Le principe du respect de la vie une fois posé (apparu à la conscience), une conséquence immédiate en est le respect dû à aux animaux – à tout ce qui vit, en fait – et donc, dans la pratique, une morale de protection du monde animal, du monde de la nature, la nature n’étant rien d’autre que l’ensemble dynamique du vivant. Schweitzer est le philosophe (et je serais tenté de dire : le seul philosophe) qui a vraiment pensé cette morale élémentaire en la déduisant d’un principe et en lui donnant ainsi la force d’un impératif logique qui s’impose à qui veut bien réfléchir.
Sensibilité et théorie
On peut aussi la pratiquer, cette morale, sans avoir réfléchi philosophiquement, mais par sensibilité, par une sorte de sentiment premier qu’on trouvera tout naturel, comme allant de soi. On est comme ça. Il y a des gens assez nombreux qui sont comme ça. « Ils aiment les animaux » ou les respectent, ont pour eux des égards, et non une agressivité meurtrière. Schweitzer était comme ça. Il était comme ça dans son enfance, il l’a raconté dans ses Souvenirs. Il a dit la peine que lui causait la vue d’un animal qui souffre et le remords qu’il éprouvait quand il en était la cause étourdie, même quand il avait seulement joué à faire peur à son chien ou à effaroucher les oiseaux. D’où vient cette sensibilité ? Il faut croire qu’elle est inhérente à l’âme humaine, à l’imagination humaine, plus ou moins développée, vive, selon les individus, inégalement répartie, injustement, en un sens, comme le sont d’autres grâces et les disgrâces.
Ayant grandi à la campagne, Schweitzer était habitué aux animaux domestiques et avait avec eux des rapports affectueux, familiers. Une photo de 1904 ou 1905 le montre à la fenêtre de sa chambre à Gunsbach en train de jouer, de parler avec son chien Sultan qui, on le devine, aimerait se promener en compagnie de son maître. Ou peut-être qu’il espère une friandise ? Dans ses lettres à Hélène Bresslau, il raconte plaisamment ses promenades et ses « conversations » avec Sultan sur le rocher du Kanzenrain. Il lui attribue des sentiments et même des réflexions. Anthropomorphisme ? Sans doute. Mais il y met de l’humour. C’est avec son « autre » amie un jeu littéraire. En tout cas, il a de la sympathie, de l’empathie pour son chien – et ça paraît réciproque ! À Lambaréné, maître dans son domaine, il adoptera de nombreux animaux, certains domestiques, chiens et chats, d’autres venus de la forêt ou du fleuve, antilopes, chimpanzés, pélicans. Il les laisse vaquer en liberté dans les allées de l’hôpital .Des images le montrant en train de les nourrir ou de les caresser feront le tour du monde et entreront dans sa légende. Illustration simple, pittoresque, de son éthique du respect de la vie, sur fond d’une entreprise éminemment humanitaire, donc centrée sur l’humain. Éthique complète. Quarante après la mort du « grand Docteur », dans un hôpital rénové, modernisé, mais toujours « village », les animaux sont revenus. Son actuel « chef », Damien Mougin, a compris qu’ils y avaient leur place, ne fût-elle que symbolique (mais ça compte, les symboles), de même qu’un potager, qu’un verger, des activités « agricoles », la culture de base. L’antilope née au village et le pélican sont enfermés dans un enclos. Ça fait petit zoo pour enfants. Artifice. Mais il y a aussi des poules et un étincelant coq qui n’appartiennent à personne de bien défini et vont en liberté. Il s’agit de vie : ensemble, en coexistence, plantes, animaux et « nous », les humains. La ville uniquement urbaine, sans nature, et le commerce général, « le monde abstrait de la marchandise », ce n’est pas la vie, ce sont des superstructures !
Ces images multiples de Lambaréné, historiques et contemporaines, font une seule image, se condensent en un symbole que l’on peut, maintenant que le concept a été dégagé, désigner comme celui de l’écologie, donc du respect de la vie. La théorie éthique de Schweitzer collait à sa sensibilité naturelle, agissante, sans phrases. Son comportement prouvait ses idées ou se manifestait comme leur conséquence « logique ». Ses idées – philosophiques – étaient concrétisées dans son action de tous les jours. Si simplement qu’on en oubliait, qu’on en oublie toujours la théorie ou qu’on la réduit à quelques vagues formules, quelques évidences. Elle est construite philosophiquement, solidement argumentée, mais on peut l’ignorer. On l’ignore.
« La philosophie européenne n’a apporté aucun soutien au mouvement en faveur de la protection des animaux. Ou elle considère ces marques de compassion envers les animaux comme une forme de sensiblerie, qui n’aurait rien à voir avec un éthique rationnelle, ou elle ne lui concède qu’une importance secondaire. »
Ces deux phrases ouvrent un article que Schweitzer fit paraître en 1936, à Londres, dans l’International Journal of Animal Protection. Elles sont toujours vraies. Les mouvements en faveur de la protection des animaux restent culturellement marginaux et leur cause n’est guère entendue par les philosophes qui n’en finissent pas de chercher le propre de l’homme (l’ingéniosité technique, la raison, la conscience, le rire, l’esprit, l’âme) dans une différence – de nature – avec l’animal. Quand ils construisent leur définition de l’homme sur ce qui fait de lui un être supérieur à l’animal, leur argument suprême, en dépit de leur darwinisme de base, est en dernier ressort d’ordre théologique : l’homme est par son âme ou son existence comme sujet, qui précède son essence, à l’image de Dieu. Il existe aujourd’hui des philosophes militants « antispécistes », mais ils sont refoulés, n’ont pas droit de cité dans les milieux philosophiques universitaires. On ne les rencontre que sur Internet.[1] Ils disent vouloir « ouvrir la possibilité d’étudier ce que nous sommes non pas contre autrui – autrui d’une autre race, d’un autre sexe, d’une autre espèce -, mais pour ce que nous sommes par nous-mêmes ». Que sommes-nous donc par (ou en) nous-mêmes ? Il y a une esquisse de réponse chez Schweitzer : « Je suis vie qui veut vivre parmi d’autres vies qui veulent vivre… » Cette réponse ne ferme pas la question, mais elle a le mérite au moins de contourner le piège, toujours tendu, de l’anthropocentrisme, ainsi d’ailleurs que celui, symétrique, du théocentrisme.
Dans maints sermons, Schweitzer a déploré le silence du christianisme (ou de l’Église) sur la souffrance que « nous » les hommes infligeons à nos « frères », les animaux. Souvent par jeu ou par routine, sans y penser. Non par méchanceté foncière, mais par méconnaissance. Donc, illusion (non, espérance !) de l’Aufklärung, une éducation corrective doit être possible, par un appel à la réflexion de chacun. Le 26 août 1900, prêchant à Gunsbach sur « Heureux les miséricordieux, car… », le jeune pasteur, vicaire, Schweitzer attire l’attention sur les associations qui se sont donné pour but de protéger les animaux contre les mauvais traitements que des hommes leur font subir. « Ce but est noble et chrétien… Et si certains d’entre vous, qui ont par ailleurs le cœur sur la main, disent qu’il importe de secourir les hommes, et non les bêtes, ils ont tort d’appuyer sur cette distinction. Notre miséricorde ne doit pas être sélective, elle doit s’étendre à tout ce qui vit… »
Quelle attitude les Églises chrétiennes préconisent-elles face à la souffrance animale ? Cette question continue à être débattue aujourd’hui. Quel progrès dans les consciences et les mœurs depuis le début du siècle dernier ? Récemment, une discussion sur ce thème fut organisée à Strasbourg, au FEC (Foyer de l’Étudiant Catholique), à l’initiative du « Collectif alsacien pour le respect de l’animal ». Selon Michel Deneken, doyen de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg, les consciences ou les sensibilités ont évolué et rendent possible maintenant « une théologie de la création et de l’écologie qui prendrait en compte la solidarité de tout le vivant ». On croirait lire du Schweitzer, sauf que le mot « écologie » n’était pas en usage à son époque. Quant à Gérard Siegwalt, professeur émérite à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, il a comme Schweitzer accusé Descartes d’être à l’origine du dualisme qui scindé l’homme-sujet pensant de l’animal-machine. Mais la vache, machine à produire du lait, est devenu folle. La nature nous résiste. Ne pas la respecter, la (mal)traiter comme un capital que nous aurions tous les droits d’exploiter, c’est à moyen terme compromettre la survie des générations futures d’humains et en tout cas c’est leur léguer, en guise d’héritage, d’énormes problèmes que les progrès techniques ne suffiront pas à résoudre.
On se permettra seulement ici de regretter qu’à cet excellent débat qui s’est tenu à Strasbourg, sa ville universitaire, Schweitzer ait été oublié (une fois encore ?), qu’il n’ait pas été… convoqué, on veut dire évoqué. Car à lire ses textes on verrait, hé oui, qu’il avait déjà pensé tout ça et que des éléments au moins des réponses éthiques que l’on cherche, dont on comprend aujourd’hui la nécessité, sont contenus dans sa théologie et dans sa philosophie, celle-ci exposée dans ses ouvrages philosophiques de 1923 comme dans ses sermons, en particulier ceux de 1919 où pour la première fois il s’était aventuré à exposer ses idées nouvelles sur le respect dû à toute vie.
[1] Les Cahiers antispécistes, « réflexion et action pour l’égalité animale » – http://www.cahiers-antispecistes.org